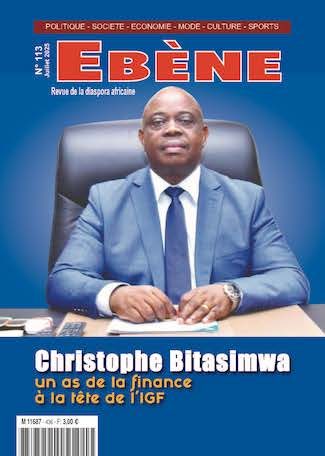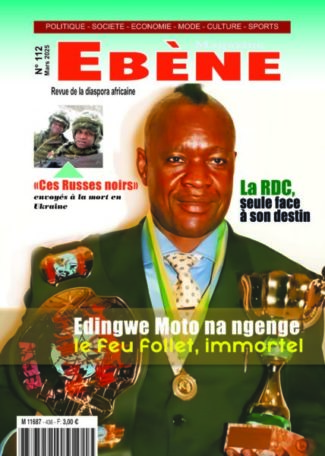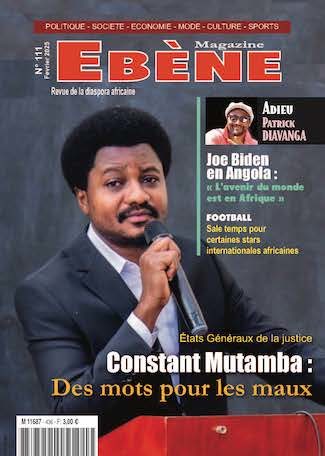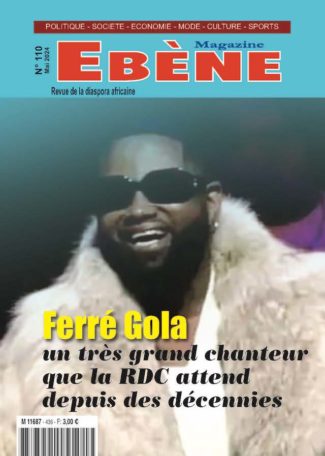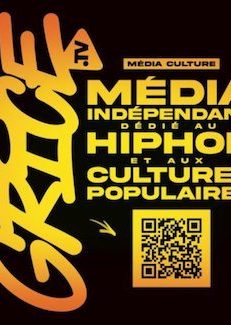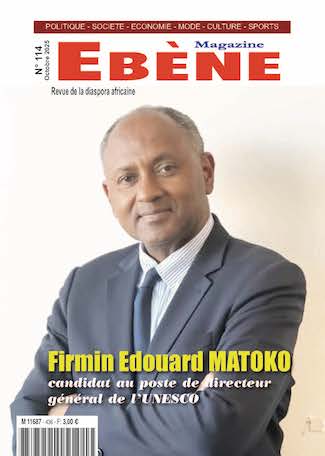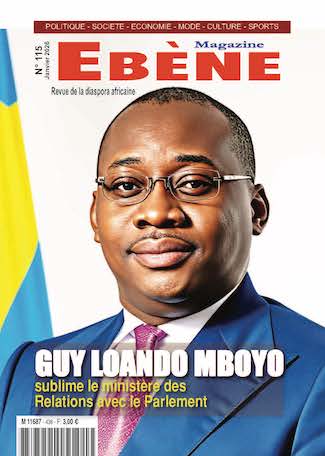Le Professeur Bruno Lapika @crédit photo: Augustin Mukamba
Le Professeur Bruno Lapika @crédit photo: Augustin Mukamba
Professeur ordinaire à l’Université de Kinshasa et directeur général du Centre de coordination de recherches et de documentation en sciences sociales desservant l’Afrique subsaharienne CERDAS, le Professeur Lapika est régulièrement entre deux avions. De passage en Suisse, nous avons recueilli ses propos notamment en sa qualité de scientifique et d’anthropologue sur des sujets d’actualité sans occulter sa casquette d’ancien député. Entretien à bâtons rompus avec le Doyen de la faculté des sciences sociales de l’UNIKIN.
AFRIQU’ÉCHOS MAGAZINE (AEM) : Professeur Lapika, peut-on connaître le but de votre visite en Suisse ?
PROFESSEUR BRUNO LAPIKA (PBL) : Je suis en Suisse dans le cadre à la fois du CERDAS et de l’Université de Kinshasa en RDC pour participer à une validation des résultats d’une étude que nous avons réalisée avec l’Institut tropical suisse sous l’égide de l’OMS sur la perception du choléra et l’acceptation anticipée du vaccin contre le choléra en RDC. Il s’agit, en fait, d’une étude multi-pays qui couvre trois pays africains : le Kenya, la RDC et le Zanzibar. La grande préoccupation de l’OMS face aux dégâts que cause le choléra dans plusieurs pays à travers le monde est d’introduire un vaccin. Mais avant l’introduction d’un vaccin, il est important d’appréhender d’abord la perception que les gens ont de la maladie, mais aussi les dispositions culturelles qui peuvent favoriser l’introduction du vaccin dans la mesure où des expériences antérieures ont montré que certains vaccins ont été rejetés par certaines communautés parce que les modes d’introduction se sont avérés inappropriés par rapport aux croyances des communautés.
AEM : Comment avez-vous procédé ?
PBL : Au pays, nous avons d’abord procédé à la collecte des données sur le choléra. Une fois les données collectées, nous avons passé à la phase d’analyse de ces données et l’Institut tropical suisse a été chargé d’analyser les données. Maintenant, nous sommes à la phase de la validation de ces données par rapport aux résultats obtenus avant de passer à la dernière étape qui est la dissémination, la publication des rapports dans des journaux scientifiques internationaux.
AEM : Vous avez évoqué le facteur culturel, comment les gens perçoivent-ils le choléra et le mode d’introduction du vaccin contre cette maladie ?
PBL : Il y a un défi énorme sur le plan scientifique entre l’introduction du vaccin et la perception que les gens ont à la fois de la maladie et du vaccin. Dans certaines communautés auprès desquelles nous avons enquêté, le choléra est causé par plusieurs facteurs notamment, pour certains, par la sorcellerie. Et lorsque dans une communauté les gens pensent que la cause du choléra est la sorcellerie et que vous venez avec un vaccin pour immuniser cette communauté, ce vaccin ne peut pas avoir un impact réel. C’est pour cela qu’il faut, dans un premier temps, dialoguer avec les communautés de manière à systématiser les causes réelles et objectives de l’apparition de la maladie, de manière à ce que le vaccin qui est introduit soit d’abord accepté puis efficace.
AEM : Comment avez-vous fait pour atteindre ces communautés sachant que le pays est vaste ?
PBL : Vous avez parfaitement raison de dire que le pays est vaste, que ce soit la RDC, le Kenya ou le Zanzibar. Pour minimiser les distances ou l’étendue du champ, nous avons d’abord sélectionné les sites. Par exemple, en RDC – je vais plus parler de la RDC parce que j’ ai piloté l’étude comme investigateur principal- nous avons choisi deux sites dont un site urbain qui est Kassenga et un site rural, Nkole, qui est pratiquement une île, dans le Katanga. Nous avons ciblé une population statistiquement évaluée à 800 personnes et ce sont ces 800 personnes qui ont fait l’objet de l’enquête. Nous avons ensuite extrapolé les résultats issus de cette enquête sur l’ensemble du territoire. Donc, ce sont des approches statistiques qui se justifient en fonction de l’échantillon que nous avons tiré. Mais, au delà de ce mode de sélection basé sur l’extrapolation, nous avons appliqué une approche qualitative de type anthropologique où nous avons identifié un certain nombre d’informateurs clé auxquels nous avons soumis ce qu’on appelle des entretiens individuels approfondis. Ces entretiens sont constitués des questions ouvertes ou des récits de vie qui permettent à l’individu de raconter tout ce qu’il connaît de la maladie et tout ce qu’il sait de l’opinion qui se développe dans la communauté. Et de tirer de ce récit là, des constats qui peuvent être considérés comme des schèmes culturels qui justifient l’interprétation de la maladie au sein de cette communauté. L’une des grandes précautions qu’il faut prendre pour ce genre d’études, c’est de dire que l’étude a été menée au sein d’une communauté précise et que les résultats peuvent être extrapolés au sein de la communauté. De cette façon, vous êtes pratiquement à l’aise par rapport à toute approche scientifique où vous avez limité votre champ d’étude.
AEM : Mais, comment est-ce que vous arrivez à comparer les résultats des études menées dans ces 3 pays ?
PBL : Nous avons des indicateurs ou des variables qui sont pratiquement les mêmes et qui nous permettent d’apprécier d’abord les différences entre le milieu rural et le milieu urbain. On a en effet un site en milieu urbain et un autre en milieu rural, on peut déjà comparer aussi bien la perception que l’acceptation potentielle
AEM : Le mode de vie aussi…
PBL : Exact, si le mode de vie est différent et que les perceptions sont différentes, cela signifie qu’il faudra des méthodes qui soient spécifiques à chaque communauté.
AEM : Pour vulgariser cette étude, à quel moyens allez-vous recourir sachant que dans ces contrées tout le monde n’a pas accès à l’information ?
PBL : Très bonne question. Parce que lors de la rencontre de Bâle (en Suisse alémanique ndlr), nous avons discuté justement autour de cette préoccupation. Les communautés qui sont intéressées ou concernées, pour la plupart, ne savent pas lire le français ni l’anglais. Comment est-ce que ces communautés seront au courant des résultats ? Alors, là, nous avons deux phases : premièrement, nous avons dit que l’OMS va publier des notes de recherche utilisant un langage accessible au commun des mortels, mais, en même temps, comme il s’agit de recherche scientifique, nous avons résolu de publier des articles scientifiques pour atteindre le public scientifique international. Parce que, ne l’oubliez surtout pas, la thématique fondamentale, c’est l’acceptation du vaccin contre le choléra. Or, ce vaccin est souvent produit par des firmes pharmaceutiques qui sont intéressées par ce type de réponses. Et parmi les groupes cibles intéressés par les résultats vous avez les firmes pharmaceutiques qui vont être les premiers à exploiter les résultats de notre étude.
AEM : Au pays, quel type de collaboration avez-vous avec les autorités dans ce genre de démarche ?
PBL : D’abord, il faut savoir que l’étude a été commandée par l’OMS Genève qui a contacté l’OMS Kinshasa. Et avant que nous ne descendions sur le terrain, nous avons été obligés de rencontrer les responsables du ministère de la santé pour solliciter d’abord les autorisations nécessaires. Ensuite, sur le terrain, nous avons dû associer à la démarche scientifique, le représentant de l’OMS du Katanga, le représentant du ministère de la santé au niveau provincial et le médecin chef de zone de Kassenga. Comme vous pouvez le constater l’étude a été, en quelque sorte, je dirais, acceptée par l’institution nationale puisque ces grandes institutions ont délégué des acteurs qui ont participé avec nous à l’étude du début à la fin.
AEM : Si j’ai bien compris il s’agit d’un projet pilote parce que vous avez ciblé certaines régions alors que la capitale est, elle aussi, concernée par ce problème du choléra ?
PBL : Oui, la capitale est concernée par le problème du choléra. Dans les termes de référence de l’étude, nous avions défini les critères que toute une communauté entre dans l’étude… Parmi les critères ce que nous avions dit, c’est que, il faudrait d’abord une communauté qui a connu les cas du choléra de manière successive durant les 3 dernières années. Et nous avons exclu certaines communautés où existent déjà des interventions.
AEM : Est-ce le cas à Kinshasa ?
PBL : À Kinshasa, à l’époque il n’y avait pas d’intervention mais maintenant oui… Mais par exemple Kalemie qui est l’un des grands foyers, en ce moment-là, Kalemie était exclu à cause des interventions des ONG déjà très impliquées dans la communauté qui risquaient de perturber la collecte d’abord, et ensuite la gestion de l’information que nous recherchions.
AEM : On sait aussi que la religion ou les croyances religieuses peuvent constituer aussi un frein à ce genre de démarches comme vous l’avez d’ailleurs évoqué au début…
PBL : C’est exact que la religion constitue, dans beaucoup d’études de santé publique un facteur parfois négatif dans la gestion des problèmes de santé. Dans le cas d’espèce, parmi les personnes que nous appelons les informateurs clé nous avons identifié également les responsables des églises, tout comme les responsables des écoles et les chefs traditionnels. Parce que ces personnes-là constituent des acteurs clé dans la collecte des informations, car elles connaissent mieux les communautés et elles sont capables de fournir des informations qui peuvent être considérées comme des informations fiables. Peut-être que votre question aurait pu être un peu plus agressive en disant mais est-ce que vous pensez qu’avec l’effervescence (prolifération) des églises, un tel projet peut avoir un impact ? Dans le cas d’espèce nous n’avons pas rencontré une opposition systématique des églises. Il est vrai que dans d’autres projets nous en avons déjà rencontrée. La présence négative entre guillemets des églises qui refusent d’admettre certaines stratégies de lutte qui sont préconisées telles que le vaccin etc.
AEM : Qu’est ce qui expliquerait ces réticences face aux vaccins ?
PBL : Le vaccin n’est pas accepté par certaines communautés soit à cause des religions soit des coutumes ou encore des rumeurs selon lesquelles tel vaccin est fait soit pour vous empoisonner, soit pour vous stériliser. Et ces rumeurs sont très répandues dans certaines communautés à tel point qu’il y a des campagnes de vaccination qui ne marchent pas.
AEM : Que font donc les autorités pour balayer ce genre de rumeurs ?
PBL : Ce que les autorités devraient faire, c’est de sensibiliser. Mais est-ce que cette sensibilisation existe ? Il faut dire que souvent elle n’existe pas, parce que les autorités ont tendance à banaliser les rumeurs. Et cette banalisation fait en sorte qu’elles ne prennent aucune mesure en termes de sensibilisation des communautés. Mais l’autre question que l’on peut se poser : est-ce que, à partir du moment où une rumeur atteint la dimension culturelle, les autorités peuvent-elles facilement combattre cette rumeur ? Je prends un exemple, lorsque le Bundu dia Kongo (un mouvement politico-culturel et religieux ndlr) déclare que tel produit qu’on vous a amené est destiné à vous décimer je ne vois pas quel est le langage que les autorités peuvent utiliser pour éliminer cela de la tête des adeptes de Bundu dia Kongo. Ou lorsque l’église catholique développe une argumentation pour dire « n’utilisez pas le préservatif », quelle est la force de l’autorité à vaincre ces croyances qui souvent relèvent des convictions religieuses. C’est là tout le travail en Afrique.
AEM : Quelle est la proportion de ces individus qui ne croient pas que le vaccin tout comme le préservatif peut sauver ou protéger ?
PBL : Parlant spécifiquement du vaccin, cela est lié à la connaissance que l’on a de l’effet réel d’un vaccin. D’ailleurs, même ici en Occident, si vous interrogez 10 personnes dans ce restaurant où nous sommes, je ne suis pas certain que vous trouverez 2 qui pourraient vous expliquer quelle est le mécanisme d’immunisation que joue le vaccin. À fortiori, en Afrique lorsque vous êtes dans une population dont une forte proportion est analphabète, démonter le mécanisme de l’immunisation de l’individu est un exercice extrêmement périlleux. Ce n’est pas tellement que les gens refusent mais c’est parce qu’elles ne comprennent pas quelle est l’action réelle.
AEM : Est-ce que vous avez un timing pour la publication ?
PBL : Nous pensons que tout le travail de dissémination des résultats devrait être terminé avant la fin de l’année. Là aussi, c’est la grande difficulté que les scientifiques ont par rapport aux bailleurs. Les scientifiques ont souvent des délais qui sont assez larges alors que les problèmes auxquels ils sont confrontés ont souvent des effets dans le court terme. On a parlé du choléra ; pendant que nous sommes en train de mener des études, il y a des gens qui meurent. Alors, faut-il attendre la fin de l’étude pour intervenir ? C’est là un défi auquel il faut faire face et, de plus en plus, on pense qu’il faut réaliser des études plutôt opérationnelles pour que les résultats soient immédiatement utilisables, sinon on fait courir des risques énormes aux populations. Il faut savoir à quel moment il faut mettre en oeuvre les résultats de l’étude. Encore faut-il que la volonté soit là pour mettre en oeuvre ou en pratique les résultats d’une étude, ce qui n’est toujours pas le cas. Il peut se faire, malgré notre bonne volonté, que l’état congolais n’exploite pas ces résultats.
AEM : Justement au niveau de l’enseignement secondaire et supérieur, auriez-vous des propositions afin que cette étude soit utilisée comme un outil de référence pour sensibiliser l’opinion ?
PBL : C’est une approche intéressante mais qui, en fait, s’éloigne des préoccupations des scientifiques. Par contre, ce qui serait intéressant c’est de voir par rapport à vous qui avez des organes de vulgarisation. Puisque les résultats que nous allons publier vont paraître dans des revues scientifiques internationales qui s’adressent à des experts, donc par conséquent inaccessibles aux communautés locales, est-ce qu’on ne peut pas trouver des organes de relais comme le vôtre pour rendre cette information plus accessible et la disséminer plus rapidement pour atteindre le plus de monde possible ? Donc, pour ce qui nous concerne, notre tâche s’arrête à ce niveau là. Donc, dans la communauté, d’autres doivent prendre le relais pour atteindre la famille, atteindre les écoles, atteindre les communautés au sens large. Je pense que c’est là où les médias, les journaux, la télévision, les organes de presse devraient être associés à la dissémination de l’information si nous voulons effectivement atteindre un plus grand nombre. Déjà, ce que nous avons constaté, c’est que dans le monde francophone il n’ y a pas beaucoup de revues scientifiques de haut niveau donc nous devons publier en anglais. Mais aussi tirer les conséquences, c’est que les 3/4 des Congolais qui ne lisent pas l’anglais n’auront pas accès à cette information. Alors, à quoi ça sert ?
AEM : Vous vous êtes intéressé également au problème de la sorcellerie des enfants à Kinshasa, vous avez d’ailleurs publié en 2007 un ouvrage sur la question. Quel est votre constat et qu’est-ce que vous pouvez dire aujourd’hui à ce sujet ?
PBL : En 2007, j’ai publié cette réflexion sur la sorcellerie des enfants à Kinshasa et en 2011 je suis en train de préparer une autre publication sur la sorcellerie des enfants en milieu rural, parce que l’étude de Kinshasa s’intéresse au milieu urbain. Dans cette étude de Kinshasa, ma préoccupation était la suivante : Comment peut-on expliquer qu’en Afrique où l’enfant est considéré comme la valeur cardinale et où chaque adulte s’identifie ou se perpétue à travers l’enfant, comment se fait-il que le même enfant est accusé de sorcellerie ? J’ai essayé de voir quelles sont les causes qui sont à la base de cela, c’est ainsi que j’ai identifié plusieurs causes qui sont à la fois d’ordre économique, d’ordre social et d’ordre culturel. J’avais pensé que ce phénomène n’existait qu’en milieu urbain ; mais voilà qu’en 2011 je me retrouve dans une étude dans le Bas-Congo où je trouve que le même phénomène surgit en milieu rural où ne se pose pas de problème de crise économique, où ne se pose pas de problème de déparentalisation ; je me dis, mais quelles sont alors les facteurs qui peuvent justifier l’émergence de ce phénomène en milieu rural ? Et là, je n’ai pas encore de réponse parce que l’étude est en cours.
AEM Ce phénomène est-il dénoncé, combattu ?
PBL : Officiellement, ce que l’on constate à Kinshasa ce qu’il y a plusieurs mécanismes. D’abord, il y a, au niveau international, la convention sur les droits de l’enfant et sur base de cette convention sur les droits de l’enfant, dans les différents tribunaux il y a ce que l’on appelle les juges des enfants qui essaient de protéger les enfants ; ça c’est sur le plan légal. Au delà de ce mécanisme de protection de l’enfant, le gouvernement congolais récupère ces enfants qu’il considère comme des marginaux et les envoie dans des centres de récupération. Sur le plan social, il existe plusieurs ONG qui ont pour mission la création de centres qu’elles appellent centres de récupération des enfants en rupture familiale qui tentent une réinsertion de ces enfants dans les familles. Toujours, sur le plan social, il existe des églises- particulièrement des églises de réveil- qui prennent en charge ces enfants et réussissent à les délivrer. Mais nous avons constaté que toutes ces mesures sont trop limitatives, que ces mesures ne s’attaquent qu’à l’épiphénomène, que toutes ces mesures ne s’attaquent pas à la cause qui produit justement ce phénomène. Et la réalité, et ça c’est l’approche anthropologique que nous développons, c’est qu’il n’existe pas d’enfant sorcier s’il n y a pas de parent qui les accusent de sorcellerie, tout comme il n’existe pas d’enfant de la rue s’il n’y a pas de parents qui les envoient dans la rue. Donc, la réalité de l’enfant sorcier ou de l’enfant de la rue est liée de manière intrinsèque aux parents. Alors, si l’enfant se retrouve dans la rue c’est qu’un parent l’a produit. Par conséquent, celui qui doit donner la réponse, c’est le producteur de l’enfant sorcier ou de l’enfant de la rue, donc le parent.
AEM : Certaines autorités utiliseraient ces enfants pour leur campagne. On a vu des images d’enfants d’au moins 10 ans avec des cartes d’électeurs… Est-ce que vous avez connaissance de ce fait ?
PBL : Oui, j’ai connaissance de ce fait, mais je ne dirais pas que les autorités les utilisent, ce n’est pas le fait des autorités, si des enfants de 10 ans ont des cartes d’électeurs, c’est un fait de la société. On peut dire qu’au delà de la société il y a ceux qui pilotent cette société donc les politiques. Mais, pourquoi, il y a-t-il des enfants de 10 ans qui ont des cartes ? Est-ce que les gens se posent d’abord cette question ? Est-ce que l’enfant a besoin de la carte ? Si un enfant a une carte, c’est que c’est un parent qui l’amène. Ce parent peut être son propre géniteur, ce parent peut être un politique, donc ce sont des adultes qui se reproduisent dans des enfants pour apporter des réponses à leurs préoccupations d’identification politique. C’est vrai qu’avec le recul on peut dire qu’il y a une instrumentalisation de l’enfant dans des opérations électorales, oui, mais à qui la faute ?
AEM : Vous êtes un ancien député à l’Assemblée nationale, vous apparteniez à l’Alliance pour le renouveau du Congo d’Olivier Kamitatu, quelles sont les attentes des gens que vous rencontrez ?
PBL : Je suis en contact permanent avec les communautés, à la base, et qui lorsqu’elles me rencontrent ont trois préoccupations majeures. La première est la survie parce que la plupart de ces communautés vivent dans une pauvreté extrême ; deuxièmement la scolarisation de leurs enfants, et troisièmement un besoin urgent d’accès aux soins de santé. Ces besoins là sont des besoins immédiats, particulièrement pour les populations en milieu rural. Par contre lorsque je suis avec des populations des milieux urbains, elles expriment d’abord des besoins en termes d’électricité, des besoins en terme d’accès à l’eau, des besoins d’emplois, et viennent ensuite les besoins que j’ai évoqués, que l’on retrouve en milieu rural c’est à dire la scolarisation, l’accès à la santé, et la survie.
AEM : Vous avez certainement pu suivre le discours du chef de l’État Joseph Kabila qui évoque un bilan positif de son action, quelle est votre réaction ?
PBL : Je l’ai suivi mais je ne voudrais pas le commenter parce que les grilles d’analyse que je vais utiliser ne sont pas les mêmes que les grilles d’analyse que lui a utilisées. Je m’explique : lorsqu’un homme politique fait un bilan, il le fait à partir d’un programme qu’il a annoncé et il voit quels sont les indicateurs qui correspondent à son programme. Mais lorsque moi, en tant qu’anthropologue, je fais une analyse, je ne pars pas de la même démarche. Je pars d’abord d’une démarche pratiquement inverse : est-ce que ce programme correspond aux besoins de la communauté ? parce que je peux, moi aussi, faire un programme, par rapport à vous, mais si je ne prends pas en compte vos besoins, je ferai un programme qui est propre à mes préoccupations. Et lorsque je fais un bilan, je fais une sorte d’auto-évaluation, il est tout à fait normal que mon auto-évaluation soit positive. Il n’y a pas de contradiction… Je crois que le grand problème c’est celui-là. Moi je m’interroge d’abord sur ce que la population voudrait et je construis mon programme sur base de ce que la population veut. Deuxièmement, j’établis les critères d’évaluation par rapport à l’attente de la population, pas par rapport aux objectifs que moi je me fixe. Donc le programme qui se fixe les objectifs, se fait évaluer sur la base des indicateurs contenus dans les objectifs, est tout à fait en contradiction avec les aspirations de la population qui ont des critères d’évaluation non pas par rapport aux objectifs mais par rapport aux attentes de cette population. C’est ainsi que je suis un peu réticent à commenter ce type de résultats.
AEM : Quelle est votre analyse de la situation à la veille des scrutins de novembre 2011 en RDC ?
PBL : C’est très difficile. Je vous donne un exemple très simple. Je vous ai dit que les gens que je rencontre me disent : « nous voulons scolariser les enfants »… D’abord, nous avons un problème de recensement et d’identification des personnes qui sont dans le besoin. Combien de Congolais ont un accès difficile à l’école ? Combien de Congolais ont un accès difficile à la santé ? D’abord, la base statistique n’existe pas. Maintenant, quand je dis oui, j’ai donné de l’eau. Mais à combien de Congolais ? On ne sait pas. On peut avoir donné de l’eau à 20 Congolais. Et quand vous en avez 10’000 dans le besoin, qu’est-ce que cela représente ?
AEM : Au cas où les résultats seraient favorables à l’opposition, cela va-t-il, à votre avis, apporter un changement ?
PBL : À l’heure qu’il est, je ne suis pas certain, parce que je me rends compte qu’il y a une absence d’une analyse objective, claire et précise des attentes et des aspirations de la population. Que les discours que nous entendons sont des discours péremptoires, qui sont faits pour la consommation, et qui n’entrent pas dans les coeurs des communautés congolaises, en tout cas, pas celles que moi je côtoie régulièrement.
AEM : Seriez-vous favorable à la mise en place d’un gouvernement de coalition pour établir un certain équilibre ? Il se trouve que c’est plutôt le système qui pose problème et non pas les hommes …
PBL : Mais je pense que vous avez posé une question et vous y avez répondu. Parce que vous avez parfaitement raison vous-même en disant que le problème est ailleurs, que le problème est dans le système. On peut former des gouvernements d’union nationale, des gouvernements de concertation, aussi longtemps que le système reste tel qu’il est, on n’obtiendra aucun résultat. Maintenant, c’est quoi le système en fait ? Est-ce le système auquel moi je fais allusion, est-ce que nous avons le même entendement ? Si oui, alors nous devons traduire ce système par une convention. Et je crois que c’est cette convention entre le peuple et les dirigeants qui manque. Lorsque vous promettez à un peuple : « je vais vous donner de l’eau », mais il faut savoir à combien de gens vous allez donner de l’eau pour que ces personnes viennent à la fin de votre mandat dire « nous étions 15’ 000 mais vous n’avez donné de l’eau qu’à 5’000 ». Votre bilan est comment ? Ce type d’élément manque cruellement à l’Afrique et cela n’est pas propre au Congo mais à l’ensemble de l’Afrique.
AEM : Vous êtes professeur à l’Université et vous côtoyez l’élite de demain ou d’aujourd’hui. Est-ce que ces gens ont la même réflexion, les mêmes avis que le petit peuple ? Est-ce que les étudiants vous font des propositions ?
PBL : Les étudiants que nous avons aujourd’hui sont différents des étudiants des années 60-70. Ces étudiants n’ont plus de propositions. Ils n’en ont plus parce qu’ils ont été tellement ramenés vers le bas qu’ils ne sont pas différents de tous les autres membres de la communauté. Je vous donne un exemple ; lorsque vous étiez étudiant dans une université, vous aviez une restauration, n’est-ce pas ? Aujourd’hui il n’y a plus de restauration. Donc l’étudiant doit se battre comme tout le monde pour trouver de quoi manger. Donc, il doit partager son temps entre les études, les cours et la recherche de la survie. Lorsque nous étions étudiants, nous avions des bourses d’études, aujourd’hui ça n’existe plus. Alors, quelqu’un qui est dans un état de privation quelle type de proposition pouvez-vous attendre de lui ? C’est ça la difficulté.| Propos recueillis par Jossart Muanza (AEM)